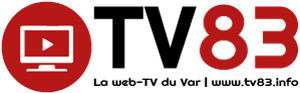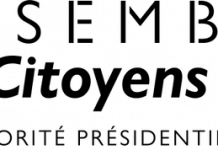Discours de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre
Cérémonie d’honneurs funèbres militaires à M. Claude LANZMANN
Hôtel des Invalides Jeudi 12 juillet 2018
Seul le prononcé fait foi
Madame, Messieurs les Ministres, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les Parlementaires, Madame la Maire,
Mesdames et Messieurs, Madame Dominique Lanzmann, Mesdames, messieurs,
 « J’avais près de soixante-dix ans, mais tout mon être bondissait d’une joie sauvage, comme à vingt ans ».
« J’avais près de soixante-dix ans, mais tout mon être bondissait d’une joie sauvage, comme à vingt ans ».
On vous comparait souvent à un ogre qui dévorait la vie avec cette « joie sauvage » que vous évoquez dans les dernières lignes du Lièvre de Patagonie. Pour Marc Bloch, l’ogre est précisément une image de l’historien : là où il sent l’humanité, là est sa mission.
Quelle a été, Claude Lanzmann, votre mission. Celle d’un historien peut-être ; celle d’un artiste, certainement ; celle d’un homme en vérité.
Il fallait un artiste pour faire l’histoire. Pas la « faire » comme acteur, même si à bien des égards, vous y avez contribué. Mais pour la dire, la montrer, la nommer, pour nous la faire toucher du doigt. Surtout celle-là. La plus sombre qui fût. Celle que certains ont tenté de faire taire. De faire disparaitre. D’anéantir. Il fallait nous en faire toucher la noirceur. De génération en génération.
Depuis le 5 juillet dernier, l’ogre, l’artiste, le lièvre qui s’est glissé « sous les barbelés infranchissables pour l’homme » des camps d’extermination se rejoignent et se confondent dans une seule et immense conscience. Bien vivante.
Une conscience qui avait le courage de son authenticité pour paraphraser le mot d’ordre de l’existentialisme.
Cette authenticité, c’est celle de la résistance en 1943, au lycée Blaise-Pascal de Clermont- Ferrand. Vous y découvrez la camaraderie des Jeunesses communistes, le maquis et la clandestinité. Vous portez des valises, avec votre amie Hélène Hoffnung, réceptionnez des armes qu’il faut cacher ou remettre aux militants du Parti communiste.
Les chemins de la liberté, vous en vivez les embuscades, les ornières avec vos camarades, exposés aux mortiers allemands ou surpris, dans les montagnes, par des miliciens. Sous vos faux noms, vous vivez déjà plusieurs vies.
Vous êtes surtout, déjà, confronté à la mort. Celle de Rouchon, le condisciple de Blaise-Pascal que vous aimiez tant. Celle de Baccot, qui se réfugie et se suicide pour échapper à la Gestapo. Des figures qui vous apprennent le courage. Le vrai. Celui du don de soi. Du sacrifice.
Mais ces figures, elles vous heurtent, elles vous bousculent. Comme tous ces héros qui nous placent, malgré eux, grâce à eux, devant nos propres lâchetés. Avec une froide honnêteté, vous avouez les vôtres. Celle qui vous retient de défendre le jeune Lévy que vos camarades de classe maltraitent en 1938 « parce qu’il est Juif ». Celle qui vous fait vous renier lorsque les mêmes vous demandent si vous êtes Juif. Celle qui vous fait fuir votre mère, dont l’apparence physique trahit, selon vous, ses origines aux yeux des bourreaux.
De ce combat, si intime et si universel, et si terriblement humain, entre le courage et la lâcheté, vous allez faire, je vous cite « le fil rouge de votre vie ». L’histoire vous en offrira hélas trop souvent l’occasion.
Ainsi, en rejoignant la Résistance comme votre père, vous vivez très jeune votre siècle. Vous découvrez aussi Paris avec votre frère Jacques, tous deux armés de fusils soviétiques marqués de la faucille et du marteau.
Ce Paris libéré, ce Paris d’après-guerre vous ouvre ses bras. En classe de lettres supérieures à Louis-le-Grand, le jeune homme d’action devient l’élève de Ferdinand Alquié, le condisciple de Gilles Deleuze et de Jacques Le Goff, l’ami intime de Jean Cau.
C’est le temps des rencontres qui orientent un destin. Beau et chanceux comme le Solal d’Albert Cohen, dont vous serez un grand lecteur puis un ami, vous vivez cent vies. Vous fréquentez Eluard, Ponge, et surtout Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir.
À leurs côtés, vous devenez un penseur engagé. Vous dénoncez la guerre d’Algérie et signez le manifeste des 121, vous publiez un dossier à charge contre les exactions et la torture, vous encouragez Jacques Vergès à intercéder en faveur des membres du FLN condamnés à mort. L’Histoire ne vous laisse jamais indifférent. Elle ne vous laisse jamais en paix.
Simone de Beauvoir. La femme à la beauté grave, intimidante, que vous invitez un soir au cinéma. Vous n’irez d’ailleurs jamais jusqu’à la salle de projection. Vous découvrez les fulgurances de la plus grande intellectuelle de son temps, dont vous chérirez l’amitié. À sa
mort, vous reprenez la direction des Temps modernes et y maintenez, je cite,« un cap de non- infidélité ».
L’existentialisme vous ouvre les yeux : en lisant les Réflexions sur la question juive de Sartre, vous comprenez votre « inauthenticité ». Trouver son authenticité, c’est lutter contre toutes les formes d’infidélité à soi-même. Vous prenez conscience de vos reniements face à l’antisémitisme dont votre mère et vos camarades ont souffert.
Certes, vous vous sentez « un vieux Français, d’une francité ancienne ». Mais, contrairement à Sartre, pour vous, ce n’est pas « l’antisémitisme qui crée le Juif ». Le voyage en Israël, ce pays qui vous est « d’emblée étranger et fraternel », est une révélation : vous êtes de vos propres mots « dedans et dehors en France, dehors et dedans en Israël ».
Vous avez découvert un peuple, le peuple juif, et vous ne le renierez plus.
Vous ne le renierez plus et vous lui bâtirez un monument. Un monument de larmes et de vérité. Un monument de stupeur qui obligera l’Humanité à regarder ses crimes et à en supporter le poids. À en écouter aussi l’éprouvant récit dans un procès au long cours, qui ne semble jamais finir. Ce monument, c’est Shoah dont le titre, gravé dans l’éternité, se suffit. Shoah, c’est une œuvre unique pour un crime unique, ce sont des visages, c’est un cri. Un refus aussi : celui de l’oubli.
Pour Pierre Vidal-Niquet, il y a Primo Levi, qui nous conjurait de ne pas oublier « que cela fut ». Il y a Raul Hilberg. Et il y a Shoah.
Pour ne pas oublier, il faut informer. Et informer, c’est d’abord donner une forme, dites-vous. Durant douze ans, avec une seule caméra 16 mm, d’un bout à l’autre de la planète, vous filmez témoins, rescapés, bourreaux. En 1985, le public découvre un film de 9h30, sans image d’archives, sans commentaires, sans mise en scène. Un film qui n’obéit à aucune règle, aucun académisme. Un film à la beauté brute, libre, sans artifice, hors-normes. Un « film-ogre » qui dévore le temps, l’espace, voire à certains moments de sa vie, son créateur. Et qui pour ces raisons, se place d’emblée au niveau des œuvres immortelles. Inoubliables. Reconnaissables.
Informer, c’est aussi nommer. Avec Shoah, vous avez nommé l’innommable, vous qui auriez voulu que ce film n’ait pas de titre. Shoah au lieu de « génocide », d’« holocauste » ou de « solution finale ». Shoah pour anéantissement, catastrophe, ruine.
Informer, c’est enfin évoquer. Non montrer, non raconter, encore moins reconstituer, mais faire renaître la texture de la réalité. Une texture qui se nourrit de silences, de phrases entrecoupées, de non-dits, de regards qui se baissent ou qui se troublent. Et dans ces regards perdus, abîmés et pour certains glacés ou indifférents, le spectateur voit la « Shoah ». Il la regarde en face, forcé de s’arrêter pour la contempler dans sa méticuleuse horreur. Comme happé par un soleil noir.
« Un certain absolu d’horreur est intransmissible », dites-vous. Quand vos témoins butent sur les mots, une voix, la vôtre, les encourage avec une douce sévérité : « Allez Abram, dites- vous au coiffeur de Treblinka que les larmes étranglent, nous devons le faire. Nous devons
continuer ». Et nous, spectateurs, craignons que ces témoins se taisent. Comme nous craignons de les écouter.
Éouter cet homme qui supplie les nazis de le tuer après avoir déposé sa femme et sa fille dans la fosse et qui s’entend répondre qu’il a encore la force de travailler.
Écouter cette femme d’instituteur allemand qui, ayant vécu en Pologne durant l’occupation, avoue froidement que « voir ça tous les jours, ça tape sur les nerfs ».
Écouter ces paysans, ces villageois, ces conducteurs de trains raconter d’une voix lasse, l’affreuse monotonie du crime étouffé, aperçu, entendu, puis vite nié ou oublié.
Dans toutes les langues, dans tous les lieux du monde, vous montrez que c’est bien notre monde, notre humanité. Au génocide qui supprime les hommes, les femmes, les enfants, les preuves et les souvenirs, à l’oubli « programmé », planifié par les bourreaux, vous opposez une mémoire terriblement vivante.
Avec Shoah, nous ne pleurons pas les morts. Nous pleurons nos morts. Nous pleurons sur nous-mêmes. Sur notre condition. Sur nos lâchetés, petites ou grandes qui rendent le crime de masse possible. Sur notre incompréhension. Peut-être pleurons-nous aussi sur notre temps. Peut-être pleurons-nous aussi, sans le savoir, sur notre avenir.
Pour vous, ce film « est une façon de revivre leur mort, les tuant une seconde fois, afin qu’ils ne meurent pas seuls, dans l’abandon absolu, mais pour que nous mourions avec eux. » En ce jour, Claude Lanzmann, vous n’êtes pas seul : nous sommes tous avec vous ; ces morts sont tous avec vous. Ils vous maintiendront vivant à jamais.
Car ces hommes et ces femmes que vous avez filmés, nous racontent aussi leur volonté de vivre. « Tout était mort en eux », disent-ils, « mais on n’est qu’un homme et il faut vivre ».
La vie, vous l’avez aimée par-dessus tout. Malgré tout. Envers et contre tout. De salles de projection en salles de classe, sans concession, sans complaisance, vous avez présenté vos films avec une netteté tranchante. Tranchante comme la vérité.
Cet amour de la vie, c’est celui que vous confessez avec gourmandise, dans votre autobiographie Le lièvre de Patagonie. Car en 2009, à 80 ans, vous avez la vigueur d’un jeune homme. Une vigueur qui vous conduit à publier un livre. Un grand livre de littérature. Un passionnant témoignage. De l’Auvergne à la Patagonie, de la Pologne à la Corée du Nord, vous ne vous lassez ni de la vie ni des rencontres.
Imprévisible jouisseur, vous saviez rire de tout, sauf de cette énigme absolue, de ce non-sens qu’est la mort qui anéantit tout. Des années après la disparition de votre sœur, Évelyne, celle de votre fils Felix vous plonge « dans les profondeurs d’abîme du malheur » qui éprouvent « les grands fers de l’amour », pour reprendre les vers de Saint-John Perse que vous récitiez inlassablement.
« Tant de derniers regards me hantent pour toujours », écrivez-vous dans Le Lièvre de Patagonie. Votre dernier regard, Claude Lanzmann, appartient à votre femme Dominique, à tous ceux que vous avez chéris et qui vous ont aimés.
Les regards que vous filmez dans Shoah, appartiennent à tous. Votre regard n’a jamais cillé. Il regardait droit, il regardait fixe pour nous forcer à voir.
Dans l’Histoire, il est des hommes qui restent pour ce qu’ils sont, parce que les évènements, souvent tragiques, leur ont donné l’occasion de se transcender.
Et dans l’Histoire, il est des hommes qui restent pour ce qu’ils laissent, pour l’œuvre qu’ils ont donné au monde et à l’Humanité. Votre mission d’Homme, Claude Lanzmann, aura été de concilier ces deux impératifs, d’être et de créer.
Ce faisant, vous avez fait exister ceux qui ne sont plus, et il n’est pas impossible que vous ayez réussi à faire exister beaucoup de ceux qui sont ici.