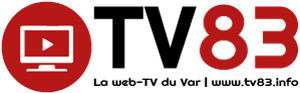Des associations militent pour le retour des « semences paysannes », ces graines ancestrales et fertiles qui sont la clé de l’autonomie alimentaire.
Des oignons de Moïta, des fèves de Luri, du blé de Canari, des pommes de Bustanico… Perdues ou ignorées pendant un temps, ces variétés sont aujourd’hui au cœur des recherches de quelques passionnés qui veulent leur redonner vie.
Derrière cette quête des « semences paysannes » se cache plus que la volonté de retrouver des variétés autochtones : il s’agit aussi de s’affranchir d’un système de sélection variétale qui, ces dernières décennies, a fait disparaître des milliers d’espèces au profit d’une poignée de semences dites « hybrides ».
Membre du réseau national Semences paysannes, qui milite pour la réintroduction des semences anciennes dans l’agriculture, Jean-Pierre Bolognini a abandonné son élevage de brebis sur le Continent pour venir s’installer à Aghione où il fait pousser des centaines de variétés de blés.
« Je ne supportais plus mon métier à cause des contraintes réglementaires qui devenaient de plus en plus drastiques et m’empêchaient de travailler comme je l’entendais. Les bêtes devenaient de moins en moins rustiques à cause des schémas de sélection », se souvient-il.
Face à des schémas qui ne lui conviennent plus, Jean-Pierre Bolognini intègre alors le réseau Semences paysannes et tombe sous le charme des blés anciens. « Il existe une vingtaine d’espèces différentes de blés, dont la plupart sont méconnues, et plusieurs dizaines de milliers de variétés de blés tendres dans le monde », chiffre-t-il. Pourtant, seule une poignée de variétés est aujourd’hui cultivée par les agriculteurs. Par quel tour de passe-passe ?
« C’est très facile !, s’exclame Ruth Stegassy, la compagne de Jean-Pierre Bolognini, ancienne journaliste à France Culture, qui s’est à son tour passionnée pour les semences paysannes. On a sélectionné les blés qui avaient le meilleur rendement, l’élite. On les a reproduits à l’identique de manière à ne plus avoir des variétés mais des clones. On a fait des blés de laboratoire qui correspondent à l’image type de ce que serait un »bon » blé, c’est-à-dire dru, avec une paille courte pour faciliter le travail au tracteur, plein de gluten car il permet de faire du pain bien gonflant dans les machines… Tout cela a abouti à ce que l’ensemble de la diversité cultivée disparaisse. »
 Heureusement, quelques graines ont résisté au rouleau compresseur de la productivité. Collectées il y a environ un siècle par des botanistes passionnés, elles sont aujourd’hui conservées précieusement dans des banques de semences en Europe mais aussi aux États-Unis ou en Russie. Jean-Pierre Bolognini et Ruth Stegassy ont ainsi retrouvé deux variétés de blés corses dans un institut des États-Unis : « Ces blés corses ont été donnés en 1921 au ministère de l’agriculture américain. À cette époque, une profusion de gens s’intéressaient à l’acclimatation des plantes et des réseaux d’échanges internationaux très dynamiques existaient. Nous avons ainsi retrouvé deux blés collectés à Canari, au hameau de Chine », explique Jean-Pierre Bolognini.
Heureusement, quelques graines ont résisté au rouleau compresseur de la productivité. Collectées il y a environ un siècle par des botanistes passionnés, elles sont aujourd’hui conservées précieusement dans des banques de semences en Europe mais aussi aux États-Unis ou en Russie. Jean-Pierre Bolognini et Ruth Stegassy ont ainsi retrouvé deux variétés de blés corses dans un institut des États-Unis : « Ces blés corses ont été donnés en 1921 au ministère de l’agriculture américain. À cette époque, une profusion de gens s’intéressaient à l’acclimatation des plantes et des réseaux d’échanges internationaux très dynamiques existaient. Nous avons ainsi retrouvé deux blés collectés à Canari, au hameau de Chine », explique Jean-Pierre Bolognini.
Ces blés sont aujourd’hui cultivés dans son jardin d’Aghione, aux côtés de quelque 200 autres variétés de blés, mais des graines ont été données à la confrérie de la Serra pour qu’elles soient ensuite redistribuées. « La dissémination est la meilleure manière de mettre les graines en sécurité », observe Jean-Pierre Bolognini.
Une culture qui se transmet
Ces blés anciens de Corse vont également être plantés sur les terrasses du village de San Martino di Lota, chez Jean-Charles Adami. Professeur de Corse au lycée Giocante de Bastia, Jean-Charles Adami a créé l’association Custodii di u creatu (Gardiens de la Création) afin de redonner vie aux semences autochtones.
D’un projet linguistique, visant à redonner toute sa place à la langue corse porteuse de savoirs agricoles, l’association est devenue un acteur de la redécouverte des plantes anciennes.
« L’idée est de récupérer des semences auprès des anciens qui en ont encore dans leur jardin et de les replanter », explique Sonia Pruvot, professeur d’histoire-géographie à Giocante. Une fois par mois, elle accompagne des lycéens volontaires dans le jardin du Sacré Cœur, en plein centre de Bastia, pour des ateliers grandeur nature.
« Depuis deux ans, l’évêché a mis à notre disposition ce terrain de 3 000 m² qui était en friche derrière l’église du Sacré Cœur pour en faire un jardin conservatoire botanique, poursuit Sonia Pruvot. Les élèves viennent planter, bêcher, ils aiment bien les travaux agricoles. » Pour retrouver des variétés anciennes, les lycéens sont incités à aller à la rencontre des anciens, dans les villages, pour les interroger sur ce qui pousse dans leur jardin.
L’enquête peut aussi les amener à interroger des instituts comme l’Inrae (ex Inra), qui possèdent parfois des collections de variétés étonnantes : un ail de Farinole a ainsi été récupéré dans un centre de l’Inrae en Bretagne.
« Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une privatisation du vivant par les grands groupes semenciers, explique la professeur. Par facilité et parce qu’on leur promettait la rentabilité, les agriculteurs sont entrés dans le système. Or, aujourd’hui, face au réchauffement climatique, on se rend compte que les variétés anciennes ont une meilleure capacité à s’adapter. »
L’oignon de Moïta résistera t-il mieux aux sécheresses que son cousin standardisé vendu en sachets dans les jardineries ? Quoiqu’il advienne, « le but est aussi de sortir des logiques mercantiles et de favoriser la transmission intergénérationnelle », estime Sonia Pruvot.
Une transmission culturelle et gratuite : les trocs de graines, où les jardiniers amateurs viennent échanger semences et connaissances botaniques, rencontrent un grand succès depuis quelques années. À Olmeta-di-Tuda, Armelle Guissani a créé le premier troc de graines en 2014.
« Le but est qu’il n’y ait pas d’argent qui circule. Les gens qui ont des choses à donner ou troquer viennent gratuitement, on discute beaucoup, on échange des savoirs », explique-t-elle. Faute de pouvoir organiser des trocs en période de crise sanitaire, Armelle Guissani a décidé de créer une grainothèque chez elle : « Je collecte des graines récupérées dans les trocs, légumes, fleurs, fruits, noyaux, avec l’indication de leur lieu de provenance et leur date de récolte. Ce ne sont que des plantes qui se sont déjà reproduites, donc pas des semences stériles, et qui sont en Corse depuis pas mal d’années. »
Riche d’une cinquantaine de variétés, la grainothèque d’Olmeta-di-Tuda est ouverte à qui veut venir chercher des semences et créer son potager. « L’idée est de tendre vers l’autonomie alimentaire et de créer du lien social. C’est aussi une démarche écologique qui va de pair avec une manière de vivre plus respectueuse de notre environnement et un renouveau dans la manière de nous alimenter », estime Armelle Guissani.
Des arbres à enraciner sur des sols vivants
En Balagne, l’association Granagora organise également des trocs et est en train de créer un « jardin de semences » au sein du Parc de Saleccia. « Le but est de produire des plants et des graines avec un référencement sur leur provenance et les méthodes de culture : en résumé, qui pousse comment et pourquoi », explique Martine Béroud, membre de l’association.
Les « jardiniers mainteneurs » qui concourent à la collection de graines ont ainsi un rôle de transmission : ce sont eux qui peuvent témoigner de l’origine des graines, léguées par leurs ancêtres, et de leur capacité à pousser dans tel ou tel environnement.
L’association ne s’arrête toutefois pas à la collection de plantes autochtones : elle s’intéresse aussi à la manière de les cultiver et défend la permaculture et l’agroforesterie, qui consiste à cultiver en mettant l’arbre au service des autres plantes grâce à sa capacité à entretenir la vie du sol.
« Ces semences seront redistribuées gratuitement avec des conseils sur les techniques de maraîchage de l’avenir, à savoir l’agroécologie, qui favorise le couvert végétal, et le maraîchage en sol vivant, poursuit Martine Béroud. Le plus dur est de changer les mentalités : ne plus mettre d’intrants, qui nourrissent seulement la plante, mais plutôt favoriser la structuration des sols pour qu’ils soient fertiles, sortir des monocultures, prendre la forêt pour modèle. » Granagora espère ainsi non seulement identifier des graines adaptées à chaque territoire mais surtout donner les clés aux jardiniers pour les cultiver de manière écologique, sur des sols vivants : « Nous pouvons retrouver des jardins vivriers en Corse si nous parvenons à nous réapproprier les gestes, à récréer les liens sociaux, à s’enraciner soi-même à la nature », estime Martine Béroud.
S’enraciner comme les arbres séculaires et fabuleux sortis de décennies d’anonymat par Pierre-Jean Luccioni. En 2007, l’auteur des célèbres albums Tempi fà découvre, à Bustanico, un pommier abandonné dont seul le berger du village avait gardé le souvenir. Intrigué, Pierre-Jean Luccioni part à la recherche des arbres fruitiers laissés à l’abandon : « Dans chaque village, il y avait une mémoire de ces arbres que les anciens greffaient », se souvient Pierre-Jean Luccioni.
Après plusieurs dizaines de tours de Corse, il parvient à un inventaire d’environ 140 variétés, pommes, poires, cerises, prunes, figues, etc., qu’il a volontairement limité aux arbres ayant un nom corse.
« Leur nom est un indicateur, cela montre que le fruit est là depuis un moment, qu’il a été greffé localement, explique-t-il. Depuis, la société rurale s’est effondrée et les arbres fruitiers en sont les victimes. Quand j’ai commencé ce travail, il y avait encore quelques vieux qui connaissaient les arbres, aujourd’hui il n’y a plus personne. »
De la poire « coscia donna » pour sa forme de cuisse de femme à la pomme « culi longa » au derrière allongé, en passant par les cerises « prefettaghje » que les notables de Casinca réservaient aux préfets au XIXe siècle, Pierre-Jean Luccioni a redonné vie à des arbres mais aussi à des mots.
« Quand on allait dans les villages et qu’on disait qu’on cherchait un pommier ou un poirier, on nous regardait comme des fous, se souvient-il. Nous sommes aujourd’hui en rupture avec notre patrimoine, les villages sont considérés comme des lieux de loisirs et non plus des lieux nutriciers. Pourtant, l’autosuffisance alimentaire serait possible en Corse si on relançait l’agriculture plutôt que d’urbaniser toujours plus. On ne mangera jamais des briques. »
Des graines très encadrées par la loi
De toutes petites graines qui provoquent de grandes discussions politiques. Depuis le 11 juin 2020, les semences dites » paysannes » sont autorisées à la vente en France, après des années de lutte des associations de défense de ces graines reproductibles. Une demi-victoire puisque leur revente n’est autorisée qu’aux acheteurs » qui ne feront pas une exploitation commerciale de la variété « , à savoir les jardiniers amateurs ou les services des espaces verts d’une collectivité. Il est donc toujours impossible pour les agriculteurs de se fournir auprès d’autres agriculteurs qui auraient conservé ces graines.
Les textes réglementaires encadrent en effet très strictement le marché de la semence. Depuis 1932, toute semence mise sur le marché doit être inscrite au Catalogue officiel des espèces et variétés végétales. Ce catalogue, géré par le Geves (Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences), avait à l’origine pour but de garantir » l’identité » des graines achetées par les agriculteurs.
Mais, au fil du temps, il est surtout devenu un moyen de réglementer drastiquement ce qui peut être planté. Pour être inscrites dans le catalogue, les semences doivent répondre à des critères imposés par l’agriculture conventionnelle : stabilité de la variété, performance, résistance,… Or, une variété naturelle peine à ne pas se recombiner avec d’autres, à avoir un rendement régulier ou à résister constamment à telle ou telle maladie.
Ainsi, ce sont les industries agrochimiques qui ont donné naissance à la plupart des variétés autorisées à la vente : ces variétés dites » hybrides F1 » sont issues d’une sélection génétique en laboratoire sur des fruits et légumes ayant des caractéristiques recherchées.
Par exemple, une tomate à la belle couleur rouge sera croisée avec une tomate à la peau solide pour en faciliter le transport. Le plus souvent, ces variétés sont même brevetées pour rester la propriété de l’entreprise qui leur a donné naissance.
Le problème, c’est que ces hybrides ne sont pas reproductibles voire sont stériles : ils donneront de beaux fruits ou légumes la première année, mais perdront en rendement la seconde ou ne produiront pas du tout. L’agriculteur est donc obligé de racheter des graines chaque année : un business rentable pour les industries semencières.
Des associations comme Kokopelli ou Semences paysannes dénoncent depuis des années ce brevetage du vivant et contournent l’interdiction de commercialiser des graines reproductibles en organisant des trocs ou des dons de semences.
Malgré la récente modification de la loi française, rien n’est gagné pour ces associations : reste à conquérir le marché des professionnels, parfois peu enclins à travailler avec ces graines à l’instabilité toute naturelle, et à convaincre la Commission européenne qui s’est opposée à la mesure adoptée par le Parlement français.
Mangeons-nous du vide ?
Des tomates qui n’ont plus de goût, des pommes privées de vitamines, des blés qui nous rendent intolérants au gluten… Notre nourriture est-elle devenue vide de nutriments voire néfaste du fait de la sélection génétique des plantes ? Le sujet est sensible et les groupes d’influence donnent chacun leur version plus ou moins objective…
Néanmoins, une étude, publiée en 2004 aux États-Unis, est relativement peu contestée. Donald Davis, chercheur à l’Institut biochimique de l’université du Texas, a étudié la composition de 43 fruits et légumes entre 1950 et 1993 à partir d’une base de données du ministère de l’agriculture américain. Résultat : en moyenne, les fruits et légumes ont perdu 6 % de protéines, 16 % de calcium, 9 % de phosphore, 15 % de fer et 38 % de vitamine B2.
Cela pourrait s’expliquer notamment par l’augmentation des rendements : en ajoutant des fertilisants et en irriguant les plantes, on » dilue » les nutriments qui les composent. En résumé, les plantes poussent trop vite et trop fort pour être concentrées en bons éléments.
Si en plus on consomme des fruits et légumes cueillis avant leur maturité afin de les transporter plus facilement, on diminue encore la quantité de nutriments ingérés, certains ne se formant qu’en fin de maturation du fruit. Paradoxalement, les légumes surgelés, s’ils ont été cueillis à maturité, assurent un apport en nutriments plus important que des légumes frais cueillis trop tôt.
En ce qui concerne le goût des fruits et légumes, difficile de savoir si notre nostalgie des » tomates qui avaient un goût de tomate » est purement psychologique ou si elle s’appuie sur une réalité. La sélection variétale des graines a plutôt cherché à rendre le goût des fruits et légumes plus agréable : les endives ont par exemple perdu de leur amertume grâce à la sélection génétique, le chou-fleur actuel est moins fort en odeur que son ancêtre.
Si les fruits et légumes n’ont » plus de goût « , c’est à cause de nos modes de consommation : une tomate consommée en plein hiver viendra nécessairement de loin et aura donc été cueillie avant maturité pour être transportée. Le goût en pâtit évidemment.
Idem pour les fruits d’été, fraises, pêches, abricots, etc., qui, s’ils étaient cueillis à maturité, arriveraient très certainement en compote dans les rayons des supermarchés. Le stockage au froid peut également inhiber le goût des fruits. Pour retrouver un peu de saveur, mieux vaut donc se tourner vers les circuits courts qui raccourcissent le délai entre cueillette et consommation.
Enfin, qui n’a pas dans son entourage une personne intolérante ou sensible au gluten ? Plus qu’un effet de mode, ce problème serait lié à la qualité des blés dont on aurait augmenté la teneur en gluten. Le gluten » natif » est présent naturellement dans la plupart des céréales : ce sont des protéines qui s’agrègent lorsqu’on leur ajoute de l’eau et permettent donc de créer des pâtes qui lèvent à la cuisson.
D’après les recherches menées par le projet GlutN, lancé en 2019 par l’Inrae, l’Inserm et le CHU de Clermont-Ferrand, les blés modernes ne contiendraient pas plus de gluten que les blés anciens. Le problème viendrait plutôt du gluten » vital « , produit industriellement et ajouté dans les produits transformés : il donne du moelleux aux pains, épaissit certains aliments, capte bien l’eau…
Et on en trouve partout, de la charcuterie industrielle aux sauces en boîte. Ce gluten est plus difficile à digérer que le gluten natif et pourrait être la cause des problèmes d’intolérance ou d’hypersensibilité au gluten, de plus en plus répandus.
Quelques chiffres
7 000 Dans le monde, sur 250 000 variétés végétales propres à la culture, seulement 7 000 sont cultivées, soit moins de 3 %. (source FAO)
12 L’alimentation des trois quarts de la population mondiale repose sur 12 espèces végétales parmi lesquelles seulement 3 (riz, blé et maïs) représentent plus de 50 % des calories issues des végétaux.
1 750 Environ 1 750 banques de graines dans le monde conservent plus de 6 millions d’échantillons de semences, soit environ 1 million de variétés distinctes.
2 000 Sur 18 millions d’hectares cultivés en France, seulement 2 000 utilisent des semences paysannes.
Un site à connaitre : www.semencespaysannes.org
Crédit-source : https://corsematin.com/articles/environnement-les-graines-de-la-liberte-116601